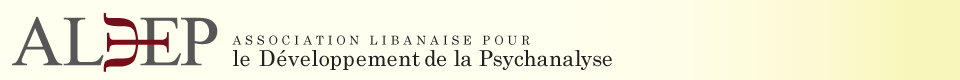Voir l'insoutenable
Le soignant face aux scènes de mutilation
(Conférence prononcée le 14 juin 2025 dans le cadre d’une table ronde durant la matinée scientifique de l'ALDeP, le 14 juin 2025)
 Quand un enfant naît, on dit qu’il ouvre les yeux à la vie. Et lorsque la vie s’éteint, une main vient refermer ses paupières après un dernier adieu. Mais entre ces deux moments, que se joue-t-il sur la scène de la vie ? Que voyons-nous ? Et qui sommes-nous, sinon les témoins muets de ce théâtre éphémère qui nous offre tantôt des scènes de violence, tantôt des feux d’artifice, des silences pleins de sens ou des cris absurdes qu’on ne comprendra jamais.
Quand un enfant naît, on dit qu’il ouvre les yeux à la vie. Et lorsque la vie s’éteint, une main vient refermer ses paupières après un dernier adieu. Mais entre ces deux moments, que se joue-t-il sur la scène de la vie ? Que voyons-nous ? Et qui sommes-nous, sinon les témoins muets de ce théâtre éphémère qui nous offre tantôt des scènes de violence, tantôt des feux d’artifice, des silences pleins de sens ou des cris absurdes qu’on ne comprendra jamais.
Nous sommes les observateurs de la vie. Elle défile devant nos yeux sans pause, sans répétition réelle. Parfois, un déjà-vu éveille en nous une émotion ancienne mais chaque image met à jour notre logiciel intérieur. Chaque image nous transforme.
Tout commence par le regard de l’Autre, le premier, celui de la mère : un bref contact visuel, tendre ou non, contenant ou fuyant, fier ou tremblant, imprime à jamais et façonne pour toujours. Ensuite viennent les couleurs, les formes, les contours flous ou précis, les lumières, les contrastes et leurs dégradés, les ombres et les ruptures. Sans en avoir encore conscience, nous voyons bien plus que ce que nous digérons.
Alors prenez garde à ce que vous regardez : ce que vous voyez vous habite.
* * *
Ce qui m’a habité dernièrement ressort de soixante entretiens effectués entre 2019 et 2020, auprès de soixante adultes qui ont vécu la guerre civile et qui y ont été impliqués d’une façon ou d’une autre. Les images que je vais partager avec vous appartiennent à l’une de ces personnes qui me les a confiées dans le cadre de ce travail de recherche, portant sur la transmission du défaut de mentalisation à la deuxième génération après la guerre civile.
C’est l’histoire d’une jeune femme qui a quitté le sud du Liban à la suite de l’invasion israélienne de 1982 pour venir s’installer seule à Beyrouth, où elle a travaillé comme infirmière. Son travail consistait à accueillir les blessés arrivant à l’urgence. Cette jeune que je vais appeler Jeannine, était l’une des premiers à les voir. Seule, terrifiée devant la mort, la violence, la mutilation et incapable de communiquer avec sa famille sauf à travers les talkies walkies de la croix rouge, cette jeune se retrouve face à des journées qu’elle décrit comme un « bain de sang » et dont elle garde les détails jusqu’à maintenant, après plus de trente ans.
Dès le début de l’entretien, quelque chose d’inquiétant au niveau de sa voix atone, de son attitude « opératoire », une sorte de détachement qui frôlait la sidération, m’intimidait. Elle ne disait que l’essentiel, répondant par « oui » ou « non », avec des phrases brèves, mesurées, parfois hésitantes. Elle semblait troublée, perturbée ; comme si mes questions, bien que simples, la surprenaient et la forçaient à choisir ses mots avec une prudence extrême. Ses réponses, pour la plupart concises, me frustraient et me poussaient à poser davantage de questions, comme pour combler le vide laissé par ses silences soudains et inattendus, silences semblables au creux, à la béance que de tels traumatismes peuvent laisser dans la structure du Moi. Je ressens l’existence d’un non-dit, qui n’est pas de l’ordre de l’informatif mais de l’ordre de l’affectif. Ce qui m’est caché, c’est l’éprouvé : un éprouvé qui semble être évité dans l’espoir d’être annulé.
Les talkies-walkies, seul moyen de communication dont Jeannine disposait avec ses parents durant la guerre, sont devenus des objets persécuteurs, sans véritable destinataire psychique, incarnant un lien vital, fragile, incertain, presque fantasmatique. On émettait un message, on attendait une réponse, sans savoir qui allait répondre, ni quand, ni même si quelqu’un le ferait. Il fallait que l’autre soit là, disponible, prêt à entendre et à contenir. Sinon, la réponse arrivait avec un délai, déformée, parfois absente, et donc pas de voix contenante possible. La communication était de surcroît hachée, morcelée, impersonnelle : pas de visage au bout du fil, pas de regard, pas d’affect partagé. Cette impossibilité de donner des détails, de raconter vraiment, transformait le lien en une tentative de survie plutôt qu’en un espace de pensée ou de partage. Trente années plus tard, le discours de Jeannine, à l’instar du fonctionnement des talkies-walkies, demeure fragmenté, fait de bribes et de récits suspendus trahissant un gel émotionnel et une sidération. La défaillance du cadre identificatoire familial, médical, institutionnel, face à une réalité qui détruit ses repères, ainsi que l’absence d’un interlocuteur capable de métaboliser pour elle ce vécu insoutenable a figé les représentations de l’adolescente en pleine réorganisation psychique et corporelle, dans un registre non pensable, les transformant en noyaux traumatiques enkystés.
Actuellement, Jeanine ne travaille plus avec les malades et occupe un poste administratif dans un autre bâtiment. Lorsqu’elle est contrainte de traverser la cour commune, elle le fait presque en courant, « pour que les souvenirs et les images qu’elle a vus durant la guerre ne la persécutent pas ». L’évitement qu’elle met en œuvre témoigne de l’atemporalité propre à l’événement traumatique. Ce qui est évité, c’est ce que l’on redoute de voir ; et ce qui n’est pas dit, c’est ce que l’on redoute d’entendre : des images ou des paroles qui, une fois vues ou prononcées, pourraient se révéler à nouveau traumatiques, par le simple effet de leur résonance, risquant ainsi de provoquer l’effondrement que l’on s’efforce d’éviter depuis des années.
Ces images persistent hors temps, hors sens, dépassant toute capacité d’intégration psychique. Elles deviennent alors persécutrices non pas parce qu’elles reviennent, mais parce qu’elles n’ont jamais pu s’absenter. Vécues sans recours symbolique et sans possibilité de transformation psychique, ces images deviennent une « terreur sans nom » au sens de Ferenczi. Passive, paralysée et incapable de bloquer ce qui se passe au-dehors, ni ce qui déborde au-dedans, le sujet a recours à l’indifférence, clivage opérant, qui devient une ultime défense et la seule forme d’économie de survie : un « mode de non-présence » face à la violence du réel. En parallèle, la honte, la culpabilité et l’isolement renforcent ce verrouillage interne. Pareilles à la cécité psychogène des soldats de la Première Guerre mondiale, l’anesthésie affective et le gel émotionnel protègent Jeannine d’une perception traumatique impossible à intégrer ou à symboliser. Là où les soldats disaient : « Je ne vois plus », son psychisme semble crier : « Je ne veux plus, ou je ne peux plus voir. » La cécité devient alors, selon Adnan Houbballah, « la limite, le bord à partir duquel le sujet bascule de la lumière dans l’obscurité. Le sujet doit alors faire le deuil d’un objet qu’il appelle “vue” » (A. Houbballah, 1998, p. 102).
Vers la fin de l’entretien, un silence raconte l’histoire écrasante creusée par ces traumas de « non-sens ». Le pouvoir de la parole et de l’élaboration, mais aussi les effets dévastateurs que Jeannine redoutait, m’ont été transmis. J’ai perçu, à mon tour, combien la parole avait ravivé des blessures profondes, impossibles à contourner, à nier ou à surmonter. À la fin de l’entretien, j’ai ressenti le besoin de lui demander si elle allait bien, et je me suis excusée de lui avoir fait revivre ces souvenirs. Le lendemain, je n’ai cessé de penser à elle, à son vécu, à ce que j’avais peut-être réveillé. À plusieurs reprises, j’ai été tentée de l’appeler, pour prendre de ses nouvelles, lui proposer quelque chose : un espace de parole peut-être ? Mais toute offre, aussi bienveillante soit-elle, risquait de mettre à nu sa souffrance, ainsi que les coûteux mécanismes de défense patiemment mis en place jusqu’à aujourd’hui. Elle aurait pu entraver, voire invalider, le lent travail du négatif auquel elle s’était livrée, silencieusement, depuis trente ans.
Un seul entretien a été suffisant pour installer un mouvement transféro-contre-transférentiel qui s’est déployé par mon besoin de l’appeler le lendemain. Cette fois à l’autre bout du talkie-walkie, je ferais aujourd’hui ce que ses parents n’ont pas pu faire jadis. Je l’écouterai et je contiendrai peut-être sa détresse.
Je ne l’ai pas rappelée, par respect peut-être à ce vécu qu’elle avait maintenu enkysté. Car l’appeler aurait été, la persécuter à nouveau, comme ces images intrusives qui la hantent. L’appeler aurait pu signifier la ramener à une condition humaine, alors qu’elle s’était façonnée en héroïne. Et pourtant, quelque chose est resté en suspens. Ces images, vues et transmises, mais restées muettes, sans sens ni symbolisation, ont laissé notre entretien ouvert, sans clôture, jusqu’à ce que ces mots soient enfin prononcés aujourd’hui.
Je vous ai présenté Jeannine, trente ans après la fin de la guerre civile, comme le témoin silencieux d’un traumatisme enkysté, maintenu à distance par le gel des affects et un clivage protecteur. Mais qu’en est-il aujourd’hui des soignants exposés aux scènes de mutilation du 4 août 2020, ou plus récemment à l’horreur des corps masculins blessés, castrés dans leur chair et dans leur image, suite à l’incident des « pagers » de septembre 2024 ?
L’impossible représentation du corps mutilé, confronte le soignant non seulement à la destruction de l’autre, mais aussi à la menace de sa propre intégrité psychique. Le regard porté sur ces corps devient insoutenable, car il confronte le sujet au morcellement et à un excès d’émotion brute. Un “élément bêta” que la pensée ne parvient pas à transformer, un résidu du réel, impensable, source d’inquiétante étrangeté.
Exposée à des scènes d’une extrême violence, Jeannine a fini par atteindre sa limite et a quitté son poste de soignante. Et pourtant, elle est restée dans le même hôpital. Elle traverse encore la cour commune, cet espace où elle accueillait autrefois les blessés. Elle retourne, de temps à autre, à l’endroit A, dans une tentative de liaison différée ou sous une forme de rêverie traumatique. La scène se rejoue silencieusement, sous l’emprise de la compulsion de répétition. On se demande alors : fuit-on ses souvenirs ? Ou bien les suit-on, dans l’espoir de les digérer un jour ?
Ces images, encore là, suspendues dans l’air sont toujours présentes, toujours menaçantes. Car le traumatisme visuel ne s’efface pas. Les images de guerre, de mort, de souffrance ne quittent pas l’esprit de ceux qui les ont traversées. Elles s’infiltrent, s’impriment, hantent. Elles se logent au plus profond de la mémoire, enkystées à vie. Et « il faut pouvoir d’abord oublier l’expérience, s’en absenter, retrouver l’éprouvé d’avant le traumatisme, pour pouvoir ensuite l’intégrer, fragment par fragment, petit bout par petit bout » (A. Ciccone, A. Ferrant, 2015, p. 266).
Face à l’insoutenable, le travail analytique ne serait pas de réparer, mais d’ouvrir un espace où le traumatisme puisse se déposer, un lieu tiers où les affects figés retrouvent mouvement et où le sujet, fragmenté, puisse commencer à se dire, même par bribes.
Références bibliographiques
Ciccone, A., & Ferrant, A. (2015). Psychanalyse du traumatisme. Paris : Dunod.
Houbballah, A. (1998). Destin du traumatisme. Paris: Hachette.
_____________
Illustration : In an Ambulance : a VAD lighting a cigarette for a patient. Olive Mudie-Cooke, 1919.