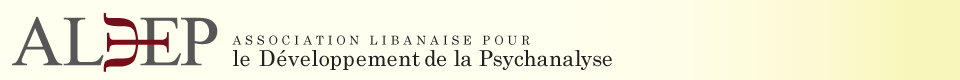Que reste-t-il de nos guerres ?
(Conférence prononcée le 14 juin 2025 dans le cadre d’une table ronde durant la matinée scientifique de l'ALDeP, le 14 juin 2025)
« C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps, c’était le temps de la sagesse, c’était le temps de la folie… » Ainsi débute Un conte de deux villes de Charles Dickens [1], sur fond de Révolution française. Cette célèbre phrase résume les contradictions d’une époque en mutation ; elle résonne étrangement avec notre monde actuel. Nous vivons un moment où les avancées technologiques et scientifiques spectaculaires cohabitent avec un état de crise. Ce malaise se manifeste particulièrement dans notre rapport aux images – notamment les images de guerre, omniprésentes et parfois insoutenables.
Les premières images de l’enfant étant sensorielles, la voix, le toucher, les rythmes corporels, tous marquent le corps avant même l’apparition du langage. C’est ce que Piera Aulagnier appelle le pictogramme – une sensation inscrite dans le corps, qui tente d’apaiser le manque. Peu à peu, ces vécus sensoriels s’organisent en pensée, grâce au langage, par un travail d’élaboration intérieure qui relie affects, traces mnésiques et mots. Ce processus se construit dans une relation à l’autre. Le regard maternel, en particulier, devient le premier écran où s’inscrivent les pensées et les affects à travers une image, l’image spéculaire.
Parler aujourd’hui d’organisation ou de désorganisation psychique, c’est souvent revenir à la qualité des premiers liens au monde. La psychanalyse, notamment celle de l’enfant, nous éclaire : comment transforme-t-on ce qu’on ressent en représentations ? Comment supporte-t-on la perte ? Comment parler de la guerre aujourd’hui, alors qu’à tout moment nous traversons des ruptures profondes, individuelles et collectives ? Le traumatisme, autant psychique que corporel, semble permanent. Dans le cadre analytique, on s’interroge sur le destin de ces images extérieures – notamment celles de la guerre – qui risquent de faire effraction.
Comme le rapporte Ernest Jones [2], en 1909, lors d’un voyage aux États-Unis avec Carl Jung, Freud tente encore une fois le cinéma à Worcester, dans le Massachusetts. Pourtant, il ne semble pas en avoir été impressionné et n’en laisse aucun commentaire. Curieusement, bien que le cinéma et la psychanalyse soient nés de la même époque, Freud garde ses distances avec l’image cinématographique, comme avec la peinture contemporaine et surréaliste de son époque – à l’exception notable de Dalí qu’il rencontra un an avant sa mort.
Freud percevait-il dans l’image visuelle une forme de séduction trop immédiate ? Avait-il une intuition des effets psychiques d’une exposition excessive aux images ? Ce rapport méfiant en dit long : la psychanalyse s’est toujours tenue à la frontière entre le visible et l’invisible, entre ce qui se montre et ce qui se pense. C’est ce que nous montre l’histoire de Imad, un homme dans la trentaine.
* * *
Imad vient consulter après la perte de sa mère et dans la crainte de perdre son emploi. Il raconte son adolescence passée devant des écrans, particulièrement les jeux vidéo, qu’il évoque comme une « distraction parfaite ». Une échappatoire face à une ambiance familiale marquée par la tension et la violence. Bien qu’il n’ait pas de souvenirs directs de la guerre, il garde des impressions floues d’un état d’alerte permanent : préserver de la nourriture pour le lendemain, nécessité de se cacher ou d’attendre les citernes d’eau en raison de la pénurie de cet élément vital, imposant le rythme même de la survie.
En février 2022, lors de l’invasion de l’Ukraine, Imad arrive un jour en séance en expliquant qu’il n’arrive plus à décrocher des nouvelles sur la guerre. Il passe des heures à regarder les images en boucle avec son père et ses frères. De séance en séance, il décrit des scènes qu’il imagine ou rapporte des rêves à travers lesquels il parvient à faire part de son agressivité aussi bien que de son effroi. Lorsque je lui demande ce qu’il cherche à voir, à savoir ou à me montrer, il répond : « On n’a pas besoin de parler. Les images parlent pour nous ! ». Ce visionnage compulsif mobilise chez lui une pulsion scopique, le besoin de voir et d’être vu, comme si les images étaient imprimées sur sa rétine. Chez Imad, cet afflux des scènes de guerre semble répondre à un besoin intérieur : celui de « travailler » quelque chose, sans encore parvenir à une élaboration psychique.
Il dit se sentir comme dans Mortal Kombat, un jeu vidéo auquel il jouait des heures durant son adolescence, happé dans une logique de survie et d’agression, oscillant entre identification au bourreau ou à la victime. Aujourd’hui encore, les chaînes d’information-continue semblent réactiver cette dynamique inconsciente. Peu à peu, le travail analytique met en lumière des souvenirs profondément inscrits en lui : l’attente, avec sa mère, le retour du père combattant. Chaque jour, l’espoir qu’il revienne « entier » et en même temps, la peur qu’il disparaisse. Une attente habitée par une ambivalence entre amour, souhaits agressifs, admiration, et rivalité. L’image devient un objet transitionnel, un support externe pour contenir une violence psychique qu’il ne peut encore élaborer autrement.
Alors que le conflit régional atteint le centre du Liban, Imad arrive un jour en séance paniqué et me dit : « C’est chez nous. » Cette fois, la guerre n’est plus un spectacle à distance. L’écran télévisé n’est plus un simple écran, car la réalité s’impose dans tous ses aspects. Nos séances, jusque-là traversées par les images télédiffusées, se déroulent désormais sur fond de sons bien réels – drones, sirènes, bombardements dans la ville même. Désormais, ce « chez nous » n’est plus seulement un lieu géographique. Il devient aussi le lieu même de l’analyse, de la relation transférentielle. Dans ce contexte de guerre, nos séances se poursuivent en visioconférence. Et là encore, quelque chose vacille. Un jour, Imad me dit : « Tu n’es pas là avec moi pour entendre ce que moi j’entends d’ici. » Les sons extérieurs et ceux de son enfance se confondent. Il me perçoit comme distante, absente, parfois même menaçante : une figure maternelle défaillante, impuissante à protéger. À ce stade, ma présence, tout comme mon regard, étaient aussi importants pour l’accompagner face aux monstres internes.
Freud, dès 1912 [3], dans ses travaux sur l’imago, montrait déjà que l’analyste devient, dans le transfert, le support d’une figure archaïque. Dans le cadre en ligne, je n’étais plus qu’un regard – une surface de projection, une présence lointaine, parfois désincarnée – mais aussi un corps, lui aussi exposé aux secousses du réel. À mesure que les combats s’intensifiaient, les images devenaient aussi sonores, hallucinées, persistantes et fragmentées. Derrière mon écran, moi aussi, je ressens un exil intérieur qui me tracasse. Est-ce une réflexion de son propre sentiment d’exil ? Un exil à deux ? Pourtant, une nécessité s’impose, celle de maintenir un espace pensable, coûte que coûte.
Lors d’une séance, un bruit de bombardement violent retentit. La séance se poursuit et Imad continue comme si de rien n’était, se raccrochant plus que d’habitude à la règle d’or. Quelques minutes après la fin de la séance, il m’écrit pour m’informer du lieu de l’explosion et confirmer qu’il va bien. Bien sûr, je savais qu’il était à l’abri de l’explosion puisqu’il était resté en ligne tout au long. Ce jour-là, j’étais devenue une part de sa scène psychique et de ses fantasmes destructeurs. La fin de la séance marque un retour à une réalité différenciée : j’étais de nouveau un objet distinct, un repère avec lequel il voulait maintenir le lien sans le détruire.
Dans le cadre en ligne, j’étais à la fois support numérique et écran psychique, surface de pare-excitation, de rêverie, ce que Bion nomme la fonction alpha. Il ne s’agissait plus seulement d’interpréter, mais de résister à la disparition symbolique. (Serge Tisseron l’a bien montré : « face au traumatisme, les images extérieures peuvent soutenir la symbolisation de représentations internes, fragiles ou incomplètes » [4].)
Les images de guerre, chez Imad, sont à la fois terrifiantes et investies de fantasmes. Il rapporte aussi des images liées au son des bottes de son père, qu’il associe au son des drones, signe de danger flottant. Même ses opinions politiques deviennent des positions affectives : soutenir la Russie, serait s’opposer à son père et à ses frères. Une guerre de représentations, reflet d’une guerre œdipienne et pré-œdipienne. Mais un tournant s’opère. Quelques semaines plus tard, nous reprenons les séances en cabinet et Imad entre en fredonnant une chanson d’enfance. Revoir les objets en place le calme. Il ressent que l’analyse, la matrice, ont tenu face à sa haine et ses souhaits inconscients hostiles, tout comme son père revenu « entier » de la guerre civile. Il ressort en chantonnant la même mélodie. Ce fredonnement agit comme une enveloppe sonore, une tentative de figuration du trauma me faisant penser à l’enfant qui s’endort au son d’une berceuse. Il mobilise une mémoire sensorielle archaïque et contenante.
Conclusion
Dans Considérations sur la guerre et sur la mort [5] (1915), Freud avance une idée étonnante : l’inconscient ne connaît pas la mort. Nous savons que nous allons mourir, mais il nous est presque impossible de nous le représenter. Cette impossibilité nous protège, mais elle nous fragilise lorsque des événements viennent forcer une confrontation brutale avec ce que nous ne pouvons pas symboliser. Autrement dit, le trauma n’est pas encore le traumatisme. Le trauma, c’est l’événement. Le traumatisme, c’est ce que le psychisme ne parvient pas à métaboliser, donc ce qui déborde. Ferenczi parle d’un clivage protecteur, mais muet, qui suspend l’élaboration. Comme chez Imad, certaines images nous marquent à jamais ; d’autres nous échappent. Cela dépend de notre seuil psychique, forgé par nos premières enveloppes et la solidité du Moi. Parfois, c’est le corps lui-même qui devient image ; à l’exemple de notre vidéo d’aujourd’hui[6] : la femme qui regarde, trente ans plus tard, sa propre photo éjectée par terre à la suite de la force de l’explosion. Elle reconnaît les bracelets à son poignet sans pour autant se reconnaitre comme sujet de l’image. C’est que cette image ne reflète pas une mémoire, mais un trou dans la mémoire — un point de mort psychique clivant la pensée, comme dirait André Green. La photo a figé l’instant du trauma, mais le lien à son identité s’est effacé. Est-ce un heureux hasard que d’avoir retrouvé cet événement, conservé dans une photo ? Ou alors un acte violent que celui de la lui montrer ? Peut-être est-ce à la fois aussi réparateur qu’intrusif, comme toute image qui véhiculerait trace, vérité et effraction.
Je pense aussi aux jeunes libanais de l’été 2024, filmant un missile tombant à quelques mètres d’eux – oscillant étrangement entre la sidération et la survie. Pour ces jeunes, l’image semble devenir un acte de décharge de la pensée par le corps. L’acte de filmer, de partager la vidéo, de se tenir à quelques mètres de la zone interdite, sont parfois des gestes de survie face à l’irreprésentable, une jouissance que celle de reprendre prise sur l’effroi.
Et pourtant, certaines images restent muettes. À Beyrouth, les murs criblés de balles ne parlent toujours pas mais en disent beaucoup. Le long silence collectif a souvent empêché le travail de mémoire et l’élaboration psychique de certains événements. C’est peut-être ce que tente le cinéma libanais, saturé de documentaires, d’archives et de récits de guerre : créer, dans l’après-coup, des liaisons symboliques pour faire émerger du sens après la catastrophe.
Alors, que reste-t-il de nos guerres ? Des traces mnésiques ou amnésiques, des ruines, des triomphes et des pertes. Depuis les arènes romaines antiques jusqu’aux places publiques de la guillotine, l’homme a toujours mobilisé la pulsion scopique pour regarder la violence en face. Il y a là une jouissance archaïque, la curiosité de voir ce que l’on redoute pour soi. Regarder la mort de l’Autre, c’est parfois tenter de conjurer la sienne. Mais lorsqu’un regard tiers – analytique, artistique ou éthique – vient contenir ces images et les relier à une parole, alors peut être cesseraient-elles d’être de pures répétitions. Ce qui reste de nos guerres, sans avoir la prétention d’en avoir la réponse, serait peut-être moins ce qu’il en reste, mais plutôt ce que nous faisons de notre guerre interne, de notre mémoire individuelle et collective, dans l’après-coup.
Références Bibliographiques
Dickens C., Un conte de deux villes, traduit par Sylvère Monod, Paris, 2002.
Jones E., La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, Tome II : Les années de maturité 1901-1919, traduction Bertrand J., Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1958, chap. XIII « Freud en Amérique ».
Freud S., (1912), “La dynamique du transfert”, dans Métapsychologie, traduction Jean Laplanche et J.-
Freud S. (1915), Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915), dans Essais de psychanalyse,trad. Jean Laplanche et coll., Paris, Payot, 1981.
Pontalis J.-B., Paris, PUF, coll. "Bibliothèque de psychanalyse", 1968.
Tisseron S., Les Empêcheurs de penser en rond, dans Comment Hitchcock m’a guéri, Paris, 2003.
[1] Dickens C., Un conte de deux villes, traduit par Sylvère Monod, Paris, 2002, p. 9.
[2] Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, Tome II : Les années de maturité 1901-1919, traduction Jean Bertrand, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 1958, chap. XIII « Freud en Amérique », p. 113-123.
[3] S. Freud, (1912), La dynamique du transfert, dans Métapsychologie, traduction Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris, PUF, coll. Bibliothèque de psychanalyse, 1968.
[4] S. Tisseron, “Les Empêcheurs de penser en rond”, dans Comment Hitchcock m’a guéri, Paris, 2003, p. 102.
[5] S. Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort (1915), dans Essais de psychanalyse, trad. Jean Laplanche et coll., Paris, Payot, 1981, p. 39.
[6] Azar G. et Shahine M., “Witness”, Al Jazeera, 2012 (Vidéo exposée dans le cadre la demi-journée scientifique de l’ALDeP 2025, minutes 31 à 35).
_________________
Illustration : Monster Flowers, Leslie Bostrom, Red Flowers, 2011.