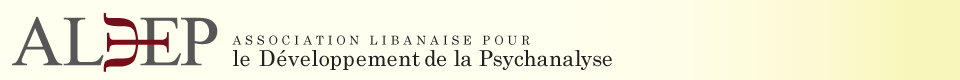Impact de la réalité externe et création de nouveau dans la relation thérapeutique
(Conférence prononcée le 18 novembre 2023 lors du colloque organisé par Psyche & Art sur le thème Improvisation, l'Imprévu, Scènes Plurielles et le 1er août 2025 lors du 54ème congrès de l'IPA à Lisbonne sur le thème Psychoanalysis: An anchor in Chaotic Times)
Improvisation 28 (1912)
Vassily Kandinsky
Guggenheim Museum, NY.
Argument : De l’imprévu et ses implications en séance à la création de nouveau ou improvisation, c’est avec ces mots que je décrirai l’expérience vécue des psychanalystes et psychothérapeutes libanais avec qui j’ai pu m’entretenir dans le cadre d’une recherche qualitative qui explore l’impact de la réalité externe sur la relation thérapeutique et le cadre. A partir de ce qui a émergé de ces entretiens, je tenterai de proposer un champ de réflexion autour de la question de la continuité de la pratique analytique dans un contexte de crises multiples et de traumas partagés avec le patient, en mettant en exergue l’aptitude du psychisme à faire émerger du nouveau face à la désorganisation que peut amener le traumatisme.
* * *
La survenue de l’imprévu en séance rend compte d’expériences analytiques singulières dans lesquelles l’inattendu surprend une écoute constante. Face à cet imprévu, l’improvisation est entendue comme la création de quelque chose sans préparation, de manière subite.
Dans l'étymologie même du mot « improviser », qui découle du latin improvisus, nous découvrons la présence du terme provisus, signifiant « prévoir ». Comment pouvons-nous donc concilier une action effectuée sans préparation avec une implication de prévision ?
Si nous nous tournons du côté de la musique, plus particulièrement vers le jazz, l'improvisation est primordiale. Pour que cette musique puisse être improvisée et rester vivante, elle doit répondre à des règles de jeu stylistiques, rythmiques et harmoniques précises, avant que d’être appropriées subjectivement et recréées par l’improvisateur. Ces règles permettent en outre aux instrumentistes de jouer et improviser ensemble sans que cela ne devienne une cacophonie. L'improvisation exige donc une maîtrise technique d’abord, et une créativité propre à l’interprète, ensuite.
Comment cette idée peut-elle s'appliquer à la pratique de la psychanalyse, et comment peut-on intégrer l'improvisation dans ce contexte ? Cette question concerne à la fois l'analysant et l'analyste, ce dernier doit pouvoir créer les conditions propices à l'improvisation. Pour l’analysant elle se fait grâce à l’association libre, sa manière de se dire, placer ses mots, ses propres « phrases musicales » ; pour l’analyste nous pensons à son désir d’analyste, son écoute flottante, sa disposition à se laisser surprendre à entendre l’aléatoire du patient, il va choisir tel mot ou tel représentation de mots. Il s’agit donc d’une improvisation structurelle propre aux contenus psychiques de la séance psychanalytique ; elle est déjà cadrée par les règles et le dispositif (Nous ferons la distinction plus tard avec l’improvisation dans le cadre analytique due à une crise externe).
Selon D. Anzieu, l'émergence du processus créateur naît d'un état de crise essentiellement à l'échelle individuelle. Mais elle peut aussi s’étendre à un couple, un groupe, ou à tout un pays. Cette crise peut se manifester sous forme de détresse psychologique, mais elle peut également découler des soubresauts des réalités sociales et politiques qui nous entourent. La crise représente un phénomène incontournable et naturel de la vie, sans lequel les individus et les collectivités ne peuvent subsister, même si elles risquent d'y succomber. Cependant, certaines crises ont le potentiel d'être productrices de créativité, et c'est précisément la nature de ces crises ainsi que notre approche à leur égard qui retiennent notre intérêt ici.
Georges et Sylvie Pragier proposent le modèle de l’auto-organisation en biologie comme métaphore pour rendre compte de l’apparition du nouveau en psychanalyse. En quelques mots, le modèle d'auto-organisation repose sur la notion d’après laquelle les systèmes biologiques peuvent émerger et s'organiser de manière spontanée à partir de perturbations aléatoires (bruit). Ces perturbations, plutôt que d'être déstabilisantes, peuvent parfois conduire à des réorganisations positives, aidant les systèmes biologiques à traverser des périodes de crise, favorisant ainsi leur adaptation et leur survie. Quelle est la nature pour le psychisme de ce nouveau qui pourrait émerger ?
Pour J. Laplanche, « il y a la capacité chez l’être humain… de créer sans cesse, près de l’origine, du sexuel à partir de toutes sortes d’ébranlements extérieurs, à partir du nouveau dont le traumatisme ne représente que le paradigme le plus dramatique. » Si nous admettons que le processus analytique est un processus auto-organisateur, l’analyste en favorisant les conditions de survenue du changement se réorganise lui aussi avec le patient. De l’inattendu, se produirait donc « une création commune » associant l’analysant et l’analyste dans « un même processus de découverte ». D’où l’intérêt de l’injonction que fait Bion à l’analyste d’être « sans mémoire ni désir » afin que puisse se produire une véritable « transformation » et non un phénomène attendu ou prévu.
Quand l’imprévu en séance survient de l’extérieur et fait effraction dans le cadre analytique, que reste-t-il de cette improvisation et de la communion entre les deux protagonistes de la scène pris par le même évènement inattendu, souvent à potentiel traumatique ?
Dans ce deuxième cas de figure, le psychanalyste improvise une variante au cadre.
De l’imprévu et ses implications en séance à la création de nouveau ou improvisation, c’est avec ces mots que je décrirai l’expérience vécue des psychanalystes et psychothérapeutes libanais avec qui j’ai pu m’entretenir dans le cadre d’une recherche qualitative explorant l’impact de la réalité externe sur la relation analytique et le cadre.
Cette recherche collaborative, née en réponse à la crise sanitaire du Covid-19, réunit des chercheurs du Liban, de France, d'Italie et du Brésil. Elle explore comment psychanalystes et psychothérapeutes ont dû remettre en question et adapter leurs pratiques et leurs cadres pour continuer à travailler avec leurs patients.
L'un de nos objectifs fondamentaux est de comprendre l'impact d'une réalité externe partagée sur le processus thérapeutique. Cette pandémie mondiale a créé un défi sans précédent pour les praticiens, les obligeant à naviguer dans un territoire inconnu, marqué par l'incertitude et la nécessité d'improviser.
Dans ma présentation d'aujourd'hui, je me concentre principalement sur la réalité du Liban. Dans le cas de pays comme le Liban, la crise sanitaire est venue se greffer sur un effondrement social, économique et politique déjà en cours, suivie par l’explosion du 4 août 2020, dont les répercussions violentes et massives ébranlent un contexte sécuritaire déjà fragilisé.
Quelques mots sur la spécificité du contexte libanais
Depuis le 17 octobre 2019, date à laquelle une série de manifestations nationales a éclaté en réponse à l'incapacité du gouvernement à résoudre la crise économique qui menaçait le Liban, la situation économique, sociale et sécuritaire du pays s'est rapidement détériorée. Le Liban a été confronté à une « triple crise » causée par l'effondrement de son économie, la pandémie mondiale de COVID-19, et l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, qui a causé la destruction de sa capitale.
Cette situation s'accompagne d'une pénurie d'essence, de médicaments, de nourriture et de produits de santé. Le pays et ses institutions sont en faillite. En outre, le Liban situé dans une zone géopolitique instable vit au quotidien une précarité politique et sécuritaire, guerres, attentats à la voiture piégée, assassinats etc.
C'est dans ce contexte d’incertitudes et d’imprévus, et avec cette histoire, que nos collègues libanais travaillent et continuent à le faire jusqu’à aujourd’hui.
J. Puget et L. Wender (1982) proposent le terme de « Mondes superposés » pour caractériser des situations dans lesquelles il existerait un risque de distorsion et de transformation dans l’écoute et la fonction analytique lorsque des faits traumatiques se retrouvent dans le matériel de séance (Puget, 1989). Pour Puget, « Le monde du quotidien, pourvu d’une forte charge traumatique, viole le champ analytique. » (Ibid, p. 5). La perte de mystère qui en découle menace l’activité sublimatoire du psychanalyste, son désir de savoir. Dans les pays où nous notons la présence préalable de conflits, la convergence entre les enjeux de la santé mondiale et les situations politiques viendrait exacerber des crises existantes et laisserait la population en proie à elle-même et à ses angoisses, sans tiers régulateur.
La question de l'asymétrie entre le patient et le psychothérapeute, « tous deux plongés dans un monde hors du fantasme » (Kac Ohana, 2016), se pose également, mettant en évidence un affaiblissement du cadre et des frontières.
Les aménagements et les remaniements des dispositifs de travail (le passage aux séances en ligne) questionnent la notion de permanence du cadre dans sa dimension matérielle et internalisée. Les fonctions de protection et de « holding » principales du cadre – dont les thérapeutes se portent garants sont ainsi mises à l’épreuve.
L’analyse des entretiens avec les collègues libanais, participants à la recherche, tente de répondre à ces multiples questions, plusieurs thèmes en émergent.
Deux thèmes nous semblent pertinents pour notre table ronde d’aujourd’hui :
Le premier, L’identité professionnelle mise à mal ;
Le deuxième, La créativité découlant du traumatisme collectif.
(Dans la partie qui suit, j’illustre les résultats par des verbatims pris des entretiens avec les participants libanais).
Une identité professionnelle remise en question
Travaillant dans un contexte de crises multiples et luttant contre la résurgence d'expériences traumatiques passées, nos participants révèlent une expérience essentiellement marquée par un sentiment d'insécurité lié à l'intrusion de la réalité externe dans leur environnement de travail. Ils évoquent une diminution de leur capacité d'écoute, de disponibilité et de contenance du patient.
« J’étais gênée de ne plus pouvoir entendre le contenu fantasmatique du discours du patient, j’avais tellement peur. » nous dit une collègue.
« Il m'a fallu un long mois pour être prête, pour être capable d'écouter, j'étais complètement paralysée, submergée. Le cadre, l'espace qui assurait une certaine continuité n'existait plus, du moins pour moi, je devais faire avec ce qui restait, ce qui existait encore. » nous dit une autre.
Ils s'interrogent sur la qualité de leur travail, car la frontière entre la résistance au traitement et la réalité reste floue dans ces circonstances (difficultés financières rendant impossible la poursuite de la thérapie).
« Par exemple, une patiente qui disait "oui, peut-être que je ne peux plus venir parce que je n'ai pas d'argent", est-ce une résistance ? Quand elle a arrêté, j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. »
Kogan, citée par A. Christopoulos (2013) dans son texte écrit pendant la crise économique en Grèce, aborde l'idée du déni défensif de la réalité externe par le psychanalyste pour tenter de neutraliser ses sentiments de détresse et d'impuissance face à l'impact traumatique de cette réalité. Il est essentiel, dit-elle, de reconnaître cette réalité afin d'assurer une fonction de contenance et de pouvoir ainsi explorer la réponse interne du patient à cette situation externe et son enchevêtrement avec son histoire personnelle et son fonctionnement.
Les participants, qu'ils soient psychanalystes, thérapeutes EMDR ou praticiens d'autres techniques thérapeutiques, se sont sentis obligés de modifier leurs approches en se concentrant davantage sur l'accompagnement que sur la psychothérapie.
« J'ai senti que je commençais à vouloir guider les gens plutôt que de faire de la thérapie. »
« Avec certains patients, pendant la pandémie, j'ai pu parler davantage, j'ai pu être plus présente, avec plus d'échanges. »
Ils évoquent également une certaine frustration concernant le paiement des séances, lorsque la manipulation et le marchandage deviennent possibles en raison de l'inflation et du passage aux séances en ligne.
« Pour ce patient, c’étaient les séances par téléphone qu'il proposait de payer à moitié prix et les séances en face à face qu'il payait comme avant. »
Les participants ont également mentionné la perte de rituels conséquente au passage au télétravail : l'espace-temps avant et après la séance, le corps et toute sa sensorialité, élément clé de la relation thérapeutique.
« Ce qui manquait aussi beaucoup, surtout pour eux, c'était tout le temps entre le départ de la maison, le trajet en voiture, tout le temps de la préparation de la séance. » nous confie G.
« Bien sûr, le corps du patient, ses réactions, parfois son apparence, parfois ses odeurs, etc. n'étaient pas là quand nous allions en ligne, mais je pense qu'ils étaient remplacés par un ton de voix plus fort, et j'ai senti que la voix devenait beaucoup plus intime et que nous étions plus attentifs aux voix. »
Nous rejoignons en cela L. Patry (2021) qui évoque les questions du manque et de la perte liés au changement du setting analytique dans les séances au téléphone. L’absence du corps prive, et le patient et l’analyste, d’une « pleine expérience transférentielle » dit-elle. L’analyste se contente de la seule parole de l’analysant pour « nourrir sa rêverie ». L’écoute flottante est concentrée sur la voix, son intonation, ses fluctuations ; peut-elle rester flottante, devient-elle plus vigilante ? Peut-on invoquer cet élément pour expliquer la fatigue souvent rapportée par les praticiens dans le passage à l’analyse à distance ?
Cela nous amène à parler du deuxième thème émergent.
La créativité issue d'un traumatisme collectif
Le cadre reconsidéré sous Covid et autres crises, se ferait sous l'effet d'une « contrainte créatrice » (Roussillon, 2009), destinée à apaiser le poids des contraintes externes et internes et à les transformer de manière acceptable, pour éviter les risques de déstabilisation identitaire. L’acte de transformation du cadre, qui consiste à changer les codes de l’écoute et de l’accueil, a probablement aussi une fonction narcissique protectrice. Pour éviter la souffrance de la confrontation à une place devenue déficitaire dans son rôle de parer à l'excitation, le thérapeute doit développer une « technique de vie » (Freud, 1930 repris par Lachal en 2002), transformant la réalité de sa relation au monde pour éviter les menaces provenant des remaniements identitaires et relationnels en cours. Le thérapeute, que la réalité externe attaque dans son identité professionnelle, son outil et sa pratique, va réagir à cet ébranlement. Il va improviser une variante au cadre. Sa technique de vie consiste à faire passer en priorité l'objectif d'évitement de la souffrance. Être heureux est surtout dans la possibilité d’exercer son travail malgré tout ; c'est avant tout ne pas souffrir d’impuissance face à la réalité castratrice.
« J'ai eu l'impression d'être plus winnicottien pendant la pandémie, et aussi face à tout ce qui se passe au Liban, qui peut parfois être pire que la pandémie. Mais je n'ai pas perdu de vue l'aspect analytique des choses. L'aspect analytique dans le sens de la technique analytique. »
« J'ai repris le travail le 7 août, sans fenêtres ni rideaux, mais je voulais quand même reprendre, pour montrer aux patients et à moi-même surtout, que c'est toujours là, et que ça continue. »
« Nous avons été confrontés à des défis qui étaient vraiment des sources de créativité que nous ne soupçonnions pas en nous-mêmes et on a beau dire que les psychanalystes sont un peu rigides, dépassés par le cours de la vie moderne etc. mais nous avons constaté que ce n'était pas le cas. »
Le passage aux séances en ligne, bien qu'il s'agisse d'une transition forcée et pour la plupart des collègues d'une première expérience, était une stratégie adaptée pour contrer la crise économique. Ils ont fait preuve d'une grande créativité dans l'aménagement de leur lieu de travail afin d'assurer la continuité du suivi de leurs patients et même d'accueillir de nouveaux patients. Beaucoup ont exprimé leur soulagement de pouvoir continuer à travailler, et pour certains, la continuité a même été décrite comme salvatrice.
« D'une certaine manière, c'est un outil qui a été introduit par la pandémie, mais qui a servi à essayer de compenser un peu la crise économique et d'avoir accès aux patients qui vivent à l'étranger et qui paient en devises étrangères, donc c'était au service de cela. »
Le recours au sport, aux activités de tout genre, groupes d’écriture, webinars etc. montre l’importance du « self-care » nécessaire aux psychothérapeutes pour se ressourcer et continuer à assurer contenance et holding à leurs patients.
« J'ai la chance d'avoir participé à un groupe d'écriture très tôt, et c'était ma seule passion créatrice en tant que psychanalyste. »
« J'avais des maux de tête, beaucoup plus que d'habitude, c'est pourquoi je faisais du yoga, le yoga me stabilisait physiquement. »
Certains ont repris des analyses personnelles, ou même des supervisions. Pour les analystes libanais, il était important de pouvoir travailler avec des psychanalystes étrangers, externes à la réalité trop présente.
« L'hiver dernier, j'ai eu besoin de cet espace alternatif de réflexion et j'ai donc eu recours à une psychanalyse en T., j’ai senti que j'avais besoin de cet espace ou de ce contenant extérieur au Liban pour me ressaisir. »
« Nous avons suivi une thérapie de groupe après l'explosion de Beyrouth, une thérapie de groupe EMDR menée par notre formateur britannique. Il s'agissait d'une thérapie de groupe en ligne. Sans cela, je pense que je n'aurais pas pu travailler avec les personnes traumatisées par l'explosion de Beyrouth. »
« J'ai parfois eu l'impression que la capacité d'écoute des superviseurs libanais était opérationnelle. Et donc, j'avais l'impression que nous étions tous dans ce même mode de fonctionnement et je n'ai pu m'en sortir qu'avec un superviseur étranger. »
Cependant, nos résultats soulignent l'incertitude des participants quant à l'environnement en ligne et à son impact sur la relation thérapeutique avec les patients.
Conformément à la perspective d'A. Green (2005), qui suggère que lorsqu'une transformation radicale du cadre est nécessaire, l'analyste devrait se tourner vers un cadre interne, celui résultant de sa propre analyse intériorisée, Soumaki et Anagnostopoulos (2018) avancent que l'idée couramment exprimée selon laquelle l'analyste est le gardien du cadre ne suppose pas nécessairement une rigidité ou une froideur automatique. En réalité, les analystes considèrent leur propre cadre psychique comme la pierre angulaire du processus analytique, garantissant qu'ils en assumeront l'entière responsabilité.
Plusieurs psychanalystes libanais ont écrit à ce propos. Khair Badawi (2011) avance que lorsque le cadre devient inaccessible en temps de guerre, ses qualités matérielles sont transposées sur la personne de l’analyste : « celui-ci n’est plus le gardien du cadre objectif, mais devient le cadre lui-même… C’est l’articulation de la relation transféro-contre-transférentielle qui va organiser la situation. »
Abdel-Malek (2022), en proposant à ses patients l’option de travailler à distance ou de reporter les séances jusqu’à son retour, essaye « de préserver une continuité dans la discontinuité et de témoigner d'une présence dans l'absence, malgré l'absence dans la présence, ce qui permettrait aux patients de « vivre la séparation sans séparation » (Winnicott, 1991, p. 146). Elle met l’accent sur le rôle du psychanalyste de porter lui-même quelques fonctions du cadre, notamment celles du sentiment de continuité.
Enfin, « lorsque le cadre est mis à l’épreuve par le réel, lorsque le processus psychanalytique est malmené́ et mis en danger, l’analyste dispose de la possibilité́, sinon du devoir de repenser le dispositif, afin d’offrir aux patients un étayage sur mesure qui permette l’enclenchement de la fonction de représentation ; l’enjeu étant de ne pas perdre de vue le cadre, tout en étant à l’écoute de son intuitivité́ et de sa créativité́ » (Khouri Naja 2021).
Pour conclure, je reviens à l'idée de la « création commune » à partir de l’imprévu. L'analyste assure la continuité du processus analytique en introduisant le nouveau dispositif, le setting du travail à distance, le cadre virtuel, tandis que l'analysant répond à l'appel en se connectant, contribuant ainsi à une co-création qui rend possible la rencontre. Cependant, dans des cas plus extrêmes, maintenir la continuité du processus analytique devient un défi lorsque le psychanalyste est confronté à l'exode de ses patients ou est lui-même contraint de partir, comme c'est le cas pour de nombreux collègues libanais, y compris moi-même. Cette expérience de rupture a un profond impact sur le cadre, car elle introduit une nouvelle dimension temporelle. Il ne s'agit plus d'une simple parenthèse, comme celle de la pandémie, des routes fermées ou du contexte d'insécurité, mais plutôt d'une situation qui s'inscrit dans la durée. Le cadre improvisé, dans ces circonstances, suppose de repenser de manière créative sa pratique et de co-construire un cadre malléable qui préserve le processus analytique. Pour y parvenir il est essentiel de pouvoir restaurer son cadre interne, cela nécessite un travail personnel mais aussi d’élaboration avec les collègues.
Références bibliographiques
Abdel-Malek, H. (2022). Working through apocalyptic times: when the psychoanalytic frame is blown up. British Journal of Psychotherapy, 00(0), 1-13. https://doi.org/10.1111/bjp.12743.
André, J. (2004). L'imprévu en séance. (n. p.) : Editions Gallimard.
Anzieu, D. (1987). Approche psychanalytique du processus créateur. CNRS Éditions.
Christopoulos, A. (2013). L’impact de la crise économique actuelle sur la dyade analytique : transformation ou déformation de la relation analytique ? Bulletin, 67, 207-216. Société Hellénique de Psychanalyse.
Freud, S. (1930 a [1929]), Le malaise dans la culture, OCF.P, XVIII, 1994.
Green, A. (2005). L’intrapsychique et l’intersubjectif en psychanalyse. Lanctôt.
Patry, L. (2021). L’écoute à distance, ses manques et ses excès. Dans M. Horovitz & P. Krzakowski (Éds.), Écrits intimes de psychanalystes pendant la pandémie : Journal de voyage en Confinia (pp. 199-206). Editions L’Harmattan.
Khair Badawi, M-T. (2011). Être, penser, créer : quand la guerre attaque le cadre et que le transfert contre-attaque. Revue Française de Psychanalyse, 75, 1035-1043. https://doi.org/10.3917/rfp.754.1035
Khouri Naja, C. (2021). La psychanalyse à l’épreuve du réel. Contre vents et marées, tenir le cadre. Revue Française de Psychanalyse, 85(4), 975–985. https://doi.org/10.3917/rfp.854.0975
Kac Ohana, N. (2016). Le psychanalyste et le fracas terroriste. Le Carnet PSY, 9(203), 18-24.
Lachal, C. (2002). La construction de la subjectivité et du lien à l'adolescence. Champ Psychosomatique, (25), 25-47. https://doi.org/10.3917/cpsy.025.0025
Laplanche, J. (1980). Problématiques III (p. 111). Presses Universitaires de France.
Lippi, S. (2016). La praxis psychanalytique, une poétique de l’improvisation. Cliniques Méditerranéennes, 93, 145-160. https://doi.org/10.3917/cm.093.0145
Pragier, G., & Faure-Pragier, S. (1990). Un siècle après l’Esquisse : nouvelles métaphores, métaphores du nouveau. Revue Française de Psychanalyse, 54(6), 1395-1529.
Puget, J. (1989). Groupe analytique et formation. Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, (13), 137-153.
Puget, J., & Wender, L. (1982). Analista y paciente en mundos superpuestos. Psicoanálisis, IV (3), 502-532.
Roussillon, R. (2009). La capacité à créer et la contrainte à créer. In R. Roussillon, Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité (pp. 151-174). Dunod.
Soumaki, E., & Anagnostopoulos, D. C. (2018). Psychoanalytic psychotherapy in times of social crisis: The impact on therapeutic relationship. Psychiatrike, 29(3), 257–263. doi: 10.22365/jpsych.2018.293.257.