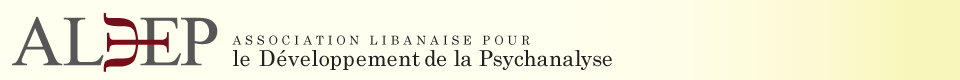Les images qui guérissent
(Conférence prononcée le 20 mars 2025 dans le cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse.)
C’est alors que quelque chose surgissait
sans faire un mouvement et se mettait
à parler sans émettre un son [1].
 « Un jour que je flânais, par un chaud après-midi d'été, dans les rues inconnues et désertes d'une petite ville italienne, je tombais par hasard dans une zone sur le caractère de laquelle je ne peux longtemps rester dans le doute. Aux fenêtres de petites maisons, on ne pouvait voir que des femmes fardées, et je me hâtai de quitter la ruelle au premier croisement. Mais après avoir erré pendant un moment sans guide, je me retrouvai soudain dans la même rue où je commençais à susciter quelques curiosités, et mon éloignement actif eut pour seul effet de me reconduire une troisième fois par un nouveau détour. Je fus saisi alors d'un sentiment que je ne peux que qualifier d'Unheimlich (non familier), et je fus heureux lorsque, renonçant à poursuivre mes explorations, je retrouvai le chemin de la Piazza que j’avais quitté peu de temps auparavant » [2].
« Un jour que je flânais, par un chaud après-midi d'été, dans les rues inconnues et désertes d'une petite ville italienne, je tombais par hasard dans une zone sur le caractère de laquelle je ne peux longtemps rester dans le doute. Aux fenêtres de petites maisons, on ne pouvait voir que des femmes fardées, et je me hâtai de quitter la ruelle au premier croisement. Mais après avoir erré pendant un moment sans guide, je me retrouvai soudain dans la même rue où je commençais à susciter quelques curiosités, et mon éloignement actif eut pour seul effet de me reconduire une troisième fois par un nouveau détour. Je fus saisi alors d'un sentiment que je ne peux que qualifier d'Unheimlich (non familier), et je fus heureux lorsque, renonçant à poursuivre mes explorations, je retrouvai le chemin de la Piazza que j’avais quitté peu de temps auparavant » [2].
Ces mots ne sont ni les miens ni ceux d’un analysant, mais ceux de Freud lui-même. Douze ans après avoir écrit sa célèbre analyse de « Gradiva, fantaisie pompéienne » de Wilhelm Jensen, il décrit une scène dont il est le protagoniste, relatant une errance et une confusion rappelant celles d’Hanold, le héros de Jensen, parti à la recherche de sa Gradiva dans une ville italienne, Pompéi.
Nous ne disposons pas de suite à cet épisode rapporté par Freud, ce qui nous laisse supposer qu’il aurait même pu précéder la parution de son ouvrage « Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen » et se rattacher à une phase bien plus précoce de sa vie. Freud lui-même ne fait-il pas remonter l’image poursuivie par Hanold à une Antiquité révolue ? D’autant plus que Hanold, archéologue, découvre le bas-relief représentant sa Gradiva parmi une collection d’antiquités.
Tout comme ces femmes fardées décrites par Freud, ce bas-relief incarne une figure féminine énigmatique et séduisante, dont la démarche singulière capte le regard d’Hanold et le précipite dans un délire persistant. Ce délire ne pourra s’éteindre qu’à la condition de retrouver cette femme à la démarche magique, celle qui hante son imaginaire et s’empare de son désir. Le mouvement du corps devient ici le déclencheur d’une quête inlassable, où l’objet de désir se confond avec l’énigme de son propre surgissement.
Renonçons à satisfaire notre curiosité quant à ce que Freud cherchait dans cette ville italienne restée anonyme et concentrons-nous sur Hanold. Après avoir découvert à Rome le bas-relief figurant sa Gradiva, il se mit à l’apercevoir partout. Prisonnier de son désir, se comparant à un oiseau en cage, il décida d’entreprendre un voyage à Pompéi, cette ville ensevelie où les histoires et les personnages, bien qu’enfouis sous les cendres volcaniques, semblent figés dans un passé presque vivant, un passé chargé d’amour, de tendresse, d’érotisme, de violence et de jouissances diverses.
Aucun autre endroit ne dépeindrait mieux une enfance ordinaire, voire banale, sur le plan fantasmatique, bien entendu, puisqu’il s’agit de l’articulation entre le désir et son impossible assouvissement. Pompéi, à travers ses corps figés et ses vestiges de vie suspendue, offre ainsi le décor d’une mise en scène où Hanold projette son désir. Derrière la figure de Gradiva, c’est un savoir refoulé qui cherche à se dire à travers l’illusion de la reconnaissance. Il se rend à cette ville à la recherche de quelque chose dont il ne perçoit encore qu’une existence pressentie, guidé par une image qui porte une histoire, la sienne.
Cette quête évoquerait celle du sujet qui entre en analyse et qui ne vient pas avec une demande explicite, mais pour savoir ce qu’il demande. Il vient donc chercher ce qui, précisément, structure son désir.
Combien de fois, en interrogeant un patient sur ce qui l’amène jusqu’à nous, entendons-nous des réponses telles que : « J’étais en train de voir un film et une scène m’a interpellé », « J’ai fait un rêve », « J’ai aperçu quelqu’un ou quelque chose dans la rue », ou encore un simple mais révélateur « Je ne sais pas ». L’élément déclencheur, souvent anodin en apparence, ne fait que révéler un point de fixation déjà actif, un signifiant resté en suspens, un désir voilé qui cherche à se dire.
* * *
Mariette, une jeune femme de vingt-sept ans, est venue en analyse en raison d’un rêve récurrent qui lui provoquait une insomnie sévère, tant elle redoutait de s’endormir. Dans ce rêve, elle se voyait poignarder sa sœur jusqu’à ce que mort s’ensuive. Avant de rendre son dernier souffle, sa sœur, allongée au sol, baignée dans son sang, fixait Mariette avec une expression qui semblait tenter, en vain, de lui transmettre un message. Puis elle mourait sans prononcer le moindre mot.
Parmi les nombreux symptômes de Mariette, qui relevaient principalement d’une constellation psychosomatique, la culpabilité occupait une place centrale. Celle-ci s’étendait à plusieurs domaines de sa vie, mais se manifestait avec une intensité particulière dans le domaine professionnel. Plus douée que sa sœur – qui était d’ailleurs son unique fratrie – Mariette se retrouvait à saboter des opportunités d’avancement dans sa carrière. Lorsque la réussite s’imposait malgré elle, son corps prenait le relais : migraines, douleurs intestinales, attaques de panique, éruptions cutanées… une série de messages, tous non vocaux, qui s’imposaient à elle comme autant d’interdits silencieux.
Ces symptômes s’aggravaient par périodes, accompagnés d’une impulsion à interrompre son analyse. Ces moments se vivaient en séance dans un silence pesant, presque oppressant, que je percevais comme une lourdeur difficile à supporter. J’avais l’impression d’amener ma patiente à révéler un secret, à transgresser une loi tacite du silence ; comme si parler revenait à trahir un pacte inconscient, un ordre familial indicible. Sa culpabilité envers sa sœur atteignait alors son paroxysme, se traduisant par une multiplication de dons d’argent ou de cadeaux, comme si elle tentait de compenser une dette qu’elle n’avait pourtant jamais contractée.
Puis, après deux ans d’analyse, un changement se produisit. Dans son rêve, la sœur mourante commença à prononcer quelques mots : d’abord « là-bas », puis « grand-mère ». Ce détail transforma radicalement le rapport de Mariette à son rêve. Au lieu de redouter le sommeil, elle souhaitait désormais s’endormir au plus vite pour en découvrir la suite. Elle était impatiente de rapporter cette évolution en séance, comme si, cette fois-ci, le message s’adressait directement à moi, son analyste, et non plus seulement à elle-même. Son insomnie, qui l’avait tant fait souffrir, disparut comme par enchantement.
Ce que je n’avais pu accomplir par mes interprétations, ces deux petits mots, « là-bas » et « grand-mère », l’avaient fait. Ils avaient ouvert une brèche, réintroduisant dans la scène onirique une parole que Mariette pouvait enfin entendre, une parole qui, en se faisant jour, fissurait le silence oppressant du rêve. Ce basculement ne pouvait rester sans conséquence. Une investigation s’imposa, et la mère de Mariette fut la première personne interrogée. Ce choix s’expliquait par deux raisons : d’une part, la grand-mère évoquée dans le rêve était la grand-mère maternelle ; d’autre part, l’expression « là-bas » semblait renvoyer à une chambre autrefois occupée par cette même grand-mère.
Ce changement évoque ce que Freud écrit sur l’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) : ce qui nous trouble n’est pas l’inconnu, mais le familier refoulé qui refait surface sous une forme dérangeante. L’angoisse naît de ce retour du Heimlich, du connu devenu méconnaissable, de ce qui fut jadis intime et qui, par un glissement, prend une dimension étrangement inquiétante. À cet égard, il est important de noter que la maison où Mariette avait grandi, et où elle vivait encore avec ses parents, appartenait aux parents de sa mère. Depuis l’âge de quatorze ans, elle occupait la chambre où sa grand-mère avait vécu jusqu’à sa mort. Imprégnée d’une mémoire familiale silencieuse, cette pièce allait jouer un rôle clé dans la compréhension de son rêve persistant.
Mon souffle de soulagement, à l’idée d’un possible dénouement, fut de courte durée. L’émergence de cette mutation dans le rêve suscita rapidement diverses résistances. La première venait de Mariette elle-même, la seconde de sa mère. Mais en y réfléchissant, je dus admettre que moi aussi, d’une certaine manière, je résistais. Mariette m’aurait peut-être mis à la place de sa mère qui s’efforçait de préserver le secret de sa propre mère, ou bien à celle de sa grand-mère dont le silence pesait encore sur les générations suivantes. Mon identification, aussi imperceptible soit-elle, aurait pu se dissimuler sous une apparente volonté de maintenir le suspense plus longtemps, comme si le dévoilement du secret devait attendre son heure.
Cependant, ce qui m’alarma avant tout fut l’état de Mariette, qui se détériorait de séance en séance. J’eus alors l’image que nous étions tous trois – Mariette, sa mère et moi-même – pris dans un même tourment, oscillant entre la nécessité de préserver un secret et l’irrépressible désir de le trahir pour enfin libérer la parole. Après tout, le rêve n’est-il pas à la fois porteur d’un message et gardien du sommeil, dissimulant et révélant en même temps ce qu’il cherche à transmettre ?
Pourtant, le rêve de Mariette ne se contenta pas de nous enfermer dans cette tension ; il eut aussi le pouvoir de nous en arracher. Il nous sortit, tous les trois, de notre quiétude apparente pour nous plonger dans l’urgence d’agir. Devions-nous poursuivre cette étrange chorégraphie de la dissimulation, où chacun semblait complice d’un secret refoulé ? Ou bien fallait-il, au contraire, accepter d’être les agents de ce rêve, en prenant le risque de révéler la vérité qu’il portait en lui ? Il me sembla que c’était à moi que Mariette avait confié le choix, tout en interrogeant mon désir.
Nicolas Abraham et Mária Török disent qu’il n'est certes pas un hasard que « l'image du fantôme nous vient pour donner un nom au tourment de l'analyste. Cette même image désigne aussi, pour le patient, l'occasion du tourment, un souvenir qu'il avait enterré, sans sépulture légale, souvenir d'une idylle vécue avec un objet prestigieux, d'une idylle qui, pour une raison, est devenue inavouable, souvenir enfoui dès lors en lieu sûr, en attendant sa résurrection » [3]. Le besoin de libérer son désir n’est donc, heureusement, pas de moindre envergure que celui de se soumettre à cette loi du silence imposée par l’Autre. Dans cette perspective, l'exemple du jeu de la bobine démontre que la répétition peut aboutir à l'élaboration, tout en restant soumise au principe de plaisir. « Même sous la domination du principe de plaisir, il reste plus d'une voie et d'un moyen pour que ce qui est en soi déplaisant devienne l'objet du souvenir et de l'élaboration psychique » [4], nous dit Freud. À mon tour, j’ajouterais que c’est à travers la situation transférentielle que la répétition aurait pu se transformer en mémoire et que les images oniriques auraient pu acquérir une signification. C’est en me plaçant tour à tour dans la position de sa mère, de sa grand-mère, de sa sœur assassinée ou encore dans celle du père protecteur qui l’aurait aidé à symboliser que Mariette fut amenée à modifier son rêve, lequel est devenu de plus en plus révélateur.
Dans la même perspective, et en revenant à Hanold, Freud souligne que l’apparition de Zoé Bertgang à l’endroit-même où il cherchait sa Gradiva marque un tournant dans notre intérêt. Il ajoute que nous pouvons même attribuer à Zoé une intention de guérir. En entendant Hanold parler de Gradiva et de la démarche qu'elle partage avec elle, elle admet pleinement le rôle de fantôme qu’il lui attribue, puis l’oriente avec douceur, à travers des paroles ambiguës, vers une nouvelle attitude. « Si la jeune femme accepte si pleinement le délire de notre héros, c’est sans doute pour l’en libérer. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire » [5]. Cette dynamique n’évoque-t-elle pas de manière exemplaire la relation transférentielle ainsi que la position de l’analyste dans cette relation ?
Avant d'avancer sur cette piste, prenons le temps d’examiner ce qui aurait causé le délire d’Hanold ainsi que le rêve de Mariette. Selon Freud, si Hanold avait refoulé tout souvenir de sa relation avec son amie d'enfance, Zoé Bertgang, c'était en raison de la culpabilité suscitée par ses fantasmes sexuels, apparus à la puberté, dont elle fut l'objet. Pour soutenir son refoulement, Hanold s'était éloigné de son amie, et une amnésie totale avait effacé toute trace de son existence. Cependant, en éliminant Zoé, Hanold avait également supprimé une partie de lui-même. Son désir en souffrance saisit l'occasion offerte par le bas-relief de Gradiva pour se lancer à la recherche de son objet perdu.
Quant à Mariette, il s'agit de libérer la voix de sa mère, et à travers elle, celle de sa grand-mère. Mais surtout, il s'agit de libérer sa propre voix, alourdie par le poids du passé. Il est temps de vous raconter l'histoire qui s'est manifestée dans le rêve. Une légende circule dans la famille : la grand-mère aurait poussé sa petite sœur du haut du grenier – qui se situe au-dessus de la chambre de Mariette – où elles jouaient ensemble, entraînant la mort de cette dernière. Ce récit n'a jamais été exprimé à haute voix, se transmettant en quelque sorte par le silence, sous la forme d'un non-dit. En même temps, les contours de l’histoire demeurent très brouillés. On ignore si l’incident mortel fut un acte délibéré, prémédité, impulsif, ou simplement un accident. Dans tous les cas, il a été condamné au silence, après avoir été revêtu d'une intentionnalité fratricide. Cette intentionnalité serait peut-être le fruit d'un certain bon sens anthropologique, d'une projection de ceux qui ont diffusé cette version, ou une manière d’éliminer symboliquement la grand-mère en question. Nous ne le saurons jamais.
Ce que nous savons, en revanche, c'est que Mariette aurait hérité de ce secret et qu'elle l'a porté à son propre compte. Sa mère, qui n’a pas eu de frères et sœurs, n'avait presque d’autres choix que de transmettre cette histoire de meurtre à ses deux filles. Dès le début, les rôles furent distribués, et Mariette se vit assigner celui de sa grand-mère. Sa place dans la fratrie aurait justifié ce choix, mais c'est surtout la ressemblance des caractères qui l'aurait consolidé : intelligente, déterminée, silencieuse, mais parfois explosive, surtout lorsque son besoin de s'exprimer ne trouvait pas de voie pour se manifester, ce qui fut une situation fréquente jusqu'ici. Ces traits de personnalité qu’elle partage avec sa grand-mère n'ont échappé à personne, y compris à Mariette elle-même. Sa ressemblance avec elle fut à la fois souhaitée et redoutée, sans qu'elle en comprenne véritablement la raison.
S'il n'avait pas été question de ce meurtre présumé, dont l'histoire, bien que recouverte de silence, fut néanmoins transmise à Mariette de manière directe et singulière, ses fantasmes fratricides auraient pu être élucidés sans grande difficulté. Sa relation avec sa sœur aurait alors suivi la loi naturelle de l'ambivalence, inhérente à toutes les relations humaines.
Cependant, chez Mariette, un effet de sidération s'est installé, la rendant, dès le départ, prisonnière de son fantasme. Cette situation évoque la manière dont Francis Bacon [6] enfermait ses peintures sous verre, permettant ainsi au spectateur d'y voir son propre visage en reflet. Elle rappelle également Freud décrivant l’expérience où, se voyant dans le miroir de son cabinet de train, se prit pour un autre, éprouvant un sentiment d’inquiétante étrangeté. De la même manière, Mariette s'est retrouvée à la place d’un autre, confrontée à un réel mortifère, non symbolisable, qui occupe son fantasme et qui insiste pour qu’un accès lui soit accordé.
Le caractère étrange de son rêve et la peur qu’il a suscitée chez elle seraient une manière d’appréhender le danger pulsionnel interne menaçant son moi de désorganisation. Ce rêve déploie un spectacle qui à la fois la fascine et la subjugue, exerçant sur elle une emprise mortifère. Il rend indispensable, pour Mariette, le besoin de voir à travers ses propres pulsions, en particulier ses pulsions agressives.
Chaque nuit, elle ressent une douleur sourde, comme si quelque chose en elle insistait, à la manière du jeu de la bobine, pour accéder au symbolique. Son rêve agit comme un révélateur paradoxal en lui permettant de voir son propre aveuglement, imposé par le secret familial et qui touche à son équilibre pulsionnel. Sophie de Mijolla souligne que « l’inquiétante étrangeté provient toujours d’un aveuglement face à une réalité à la fois sue et méconnue, qui revient de l’extérieur » [7]. Ce rêve ne se contente pas de révéler cet aveuglement forcé, il opère également comme un levier de transformation. Alors qu’il met en lumière la tension entre le su et le méconnu, il ne se limite pas à une prise de conscience passive. Il devient un nouveau symptôme, un passage du non-dit à l’exprimable. En substituant à la douleur muette du soma une image parlante, il ouvre un espace où l’imaginaire joue un rôle central, celui d’un médiateur entre le réel et le symbolique, entre une souffrance indicible et une douleur désormais signifiante, porteuse d’un message de salut.
Peu à peu, Mariette se retrouve dans l’urgence d’un passage du registre imaginaire au registre symbolique, de la représentation des choses à la mise en mots de son expérience. Pour ces patients ancrés dans un registre primaire – qu’il s’agisse de troubles psychosomatiques ou de problématiques de l’agir – la posture de l’analyste se rapproche de celle d’une mère en état de rêverie. En prêtant ses propres images au patient, elle l’aide à transiter du réel du corps ou de l’acte à celui de la parole, ouvrant ainsi une voie vers une élaboration psychique plus profonde.
La question centrale qui se pose à nous aujourd’hui concerne notre position, en tant qu’analystes libanais, face à l’afflux des images scopiques, mais aussi des images sonores (olfactives et autres) nous provenant du réel de la guerre, dont l’un des chapitres les plus meurtriers vient tout juste de se clôturer – si tant est que l’on puisse parler de clôture.
Quelle posture adopter face aux images apportées par les analysants, lorsqu’elles se rattachent à une expérience collective dont l’analyste lui-même a été partie prenante, plongé dans ce même vécu ? Comment faire face à son propre réel, à sa propre consternation, pour rester disponible à ses patients, pour continuer à rêver et pour symboliser le cauchemar de la guerre et de la violence récurrente ? Comment l’analyste pourrait-il distinguer ce qui relève d’attaques externes – celles qui proviennent du patient dans le cadre analytique et qui se font beaucoup plus nombreuses actuellement ou, plus largement, de la réalité extérieure – et ce qui relève d’attaques internes, issues de l’activation de ses propres pulsions de mort en résonance avec la violence environnante ?
Ces interrogations restent ouvertes. Je ne tenterai pas d’y répondre ici, car il me faudrait sans doute plus de recul. Je les soumets néanmoins à la réflexion du public et des collègues présents aujourd’hui. Elles méritent aussi d’être explorées dans d’autres espaces de discussion et d’échange, et je ne doute pas qu’elles le seront.
La seule réponse que je pourrais apporter en tant qu’analyste – et qui s’inspire également d’un film que certains d’entre vous ont vu avec nous l’année dernière, Memory Box – est que les images n’ont de salut que si elles sont transformées en paroles. D’un vécu figé (sous la glace québécoise dans le film), cristallisé dans un passé qui a tenté, en vain, de rompre tout lien avec le présent et l’avenir, il s’agit d’entreprendre une traversée. Une traversée, certes, encore une fois, mais une traversée différente, innovante. Un cheminement à travers lequel le vécu traumatique, jusque-là indicible, pourrait devenir une expérience subjective, trouvant sa place dans une chaîne signifiante et redonnant au sujet la possibilité de transformer le sens qu’il attribue à sa propre existence.
N’est-ce pas précisément ce qu’a fait Alex – la fille de Maia dans Memory Box – en fouillant dans les photos de sa mère et en faisant correspondre les paroles issues des enregistrements ou directement prononcées par sa mère avec ces images ? Ou Hanold, en surmontant le silence imposé par son propre vécu traumatique pour s’engager dans un périple laborieux à la recherche de cette partie de lui-même qu’il avait refoulée ? Ce n’est qu’en ôtant la cendre d’un passé figé, à l’image de celui, ô combien symbolique, de Pompéi, qu’il a finalement trouvé accès à la parole. Cependant, il n’a pu y parvenir tout seul. Il n’a véritablement accompli cette quête que lorsqu’il a rencontré un interlocuteur qui n’était autre que l’objet même de sa recherche. Zoé, cette partie manquante de Hanold, sa sexualité refoulée, est venue lui dire : « Tu es cela » [8], à la manière dont Lacan décrit l’aboutissement d’une analyse.
C’est la même réponse qu’en tant qu’analyste, j’aurais apporté à Mariette, en lui disant : « Tu es celle qui, sur le plan fantasmatique, pourrait tuer sa sœur sans que cela fasse de toi une meurtrière. Tu es celle qui a toujours été rendue responsable de sa sœur, mais qui, en même temps, a toujours aspiré à retrouver l’élan total de son désir, à déployer ses pulsions – en particulier agressives – pour aller plus loin ». Ce meurtre, rendu possible et nécessaire par le rêve, s’est néanmoins heurté au réel du fratricide, tout comme un fantasme de scène primitive ou un fantasme œdipien incestueux pourrait se confronter à un traumatisme sexuel réellement vécu dans l’enfance. Cette collision entre fantasme et réalité crée une faille, une béance au sein même du sujet, dans son vécu fantasmatique ; une faille que le symptôme viendrait tenter de combler. Je précise toutefois que le réel traumatique ne se situe pas toujours à l’extérieur du sujet. Le cas de Hanold en est une parfaite illustration. C’est une sexualité vécue comme un réel traumatique qui a conduit le héros de Jensen à cliver une partie de lui-même, à la reléguer dans une zone d’ombre inaccessible, tout en cherchant à la compenser ailleurs. Plutôt que d’explorer les souterrains de son propre inconscient, il s’est tourné vers des espaces extérieurs, des figures substitutives, des vestiges du passé, tentant ainsi d’exorciser ce qu’il ne pouvait affronter en lui.
De l’image figée ou de la scène indicible, Hanold et Mariette sont tous les deux passés à la parole, grâce à la présence d’un interlocuteur qui a accepté la place qui lui a été assignée. Un interlocuteur qui s’est prêté au rôle qu’on lui avait confié, rendant possible, parfois par son seul silence, ce que Gérard Bonnet appelle « cette restauration ou cette instauration » qui, selon lui, « est l’une des tâches primordiales qui s’impose à la relation thérapeutique »[9]. Cette disponibilité de l’analyste, à l’instar de celle de la mère, permet l’activation de la pulsion de savoir qui se résume dans cette entreprise de substitution des mots aux images. « Cela implique non seulement de pouvoir conserver l'image dans son irréductibilité première, mais aussi de chercher sans cesse les mots qui permettent…de la fixer pour soi sous une forme accessible dans le symbolique » [10].
Il s’agit donc d’une image qui est destinée en dernier recours au sujet lui-même. Si Hanold recherche la Gradiva, c’est qu’il se cherche lui-même. De même, Mariette, qui tue sa sœur dans son rêve, c’est qu’elle voudrait surmonter le tabou qu’imposa à elle et à la famille entière une histoire aux contours flous mais brûlants, se rapportant à un présumé fratricide. Elle voudrait être libre d’aimer et de haïr sa sœur, se donnant ainsi le droit de circuler entre ses pulsions opposées. De la dichotomie représentée par un amour total et totalitaire pendant la journée et un meurtre qui se déroule la nuit, elle voudrait passer à une relation harmonieuse avec sa sœur, mais au-delà de celle-ci, avec elle-même, avec son corps, sa sexualité et son désir. En ajoutant des mots à son rêve jusque-là muet, nous dirions avec Piera Aulagnier que Mariette aurait acquis « la possibilité d'adjoindre à la représentation de choses la représentation de mots qu'elle doit à la perception acoustique une fois que cette dernière a pu devenir perception d'une signification ». Aulagnier rajoute : « de cette signification, la voix de l'autre est la source émettrice » [11]. Cet autre fut d’abord la sœur dans le rêve qui, en mourant, a livré deux mots. Ces deux mots en ont généré beaucoup d’autres par la suite. Toute une investigation a eu lieu en dehors, mais surtout à l’intérieur du cadre analytique où Mariette a pu interroger sa place dans la famille, mais aussi sa place dans la généalogie familiale qui lui assignait un rôle qui s’est emparé de son désir en s’y substituant, agissant à la manière de ce que Adnan Houbballah appelle un « intrus qui refuse de livrer son identité…une représentation personnelle dont la reconnaissance implique un changement dangereux de la disposition du moi » [12]. C’est pourtant à travers cette reconnaissance que Mariette avait œuvré dans son analyse, non pas pour s’y soumettre, mais au contraire pour s’en libérer. Par moments, elle me percevait comme un témoin de sa révolte et un allié, surtout lorsque j’interprétais ; par d'autres, comme un oppresseur, faisant, par mon silence, écho à celui imposé par sa famille. Cependant, cette oscillation entre ces deux positions lui a permis de libérer son désir, sans pour autant substituer le désir de l’Autre analyste, en tant que successeur de l’Autre familial, à son propre désir.
En tournant son regard vers son analyste, Mariette devait, à l’image du bébé décrit par Winnicott qui regarde le visage de sa mère, être capable de se voir elle-même. Ceci est certainement plus facile à dire qu’à faire. Combien de fois étais-je tenté de venir à sa rescousse, de précipiter une interprétation qui, dans ma pensée magique, serait capable d’accélérer le processus et de délivrer ma patiente de sa souffrance ? Combien de fois ai-je voulu monter dans ce grenier et empêcher le meurtre qui fut à l’origine de ce drame ? Mon fauteuil d’analyste, qui fut à la fois le garant d’une abstinence à l’égard de toutes ces tentations, rendit en même temps possibles ces déplacements dans le passé individuel et familial de Mariette et me permit de l’accompagner dans ce périple laborieux où elle devait revisiter son passé pour s’en libérer, et peut-être libérer la parole de toute sa famille.
J’avoue que ce ne fut nullement une tâche facile, ni pour Mariette ni pour moi-même. En même temps qu’elle, je me suis trouvé face à mes propres non-dits, ou non-sus, et un travail interne fut indispensable pour que je puisse garder le rythme. En interrogeant mon désir, je voulais savoir pourquoi j’avais accepté de l’accompagner alors qu’au cours de son trajet, je ne savais souvent dans quelle direction elle me menait et je ne savais quoi dire ni comment interpréter ? Je l’ai fait car, peut-être, je me consolais à l’idée formulée par Lacan, qui dit que « la psychanalyse ne consiste pas à donner des interprétations astucieuses et en finesse, et que, à tout prendre, ce dont il s'agit, c'est de donner à long terme en retour au patient ce que le patient apporte. Si je fais suffisamment bien cette tâche, le patient trouvera son propre soin, sera capable d'exister et de se sentir réel » [13].
En effet, ce fut heureusement ainsi que les choses advinrent. Trois ans après l’occurrence du rêve, Mariette avait presque entièrement transformé sa vie. Elle avait trouvé un nouveau poste et, pour la première fois, se sentait satisfaite sur le plan professionnel. Sur le plan affectif, elle avait rencontré un homme qui, à l’inverse de ses précédents compagnons, l’aidait à voir en elle tout ce qui faisait sa valeur. Ses douleurs somatiques, bien que toujours présentes, étaient devenues bien moins fréquentes et bien moins intenses qu’auparavant. Par moments, elles disparaissaient même complètement, parfois pendant de longues périodes. Il en allait de même pour la culpabilité qu’elle éprouvait envers sa sœur. Mettre fin aux sacrifices qu’elle faisait à son égard s’était révélé bénéfique, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa sœur, qui était sortie de son rôle de victime pour enfin prendre sa vie en main.
Quant au rêve, cette image parlante, il s’était évanoui, comme s’il avait accompli sa mission : transmettre un message avant de disparaître. Il était venu parler à Mariette d’une martyre en elle, une partie d’elle-même qu’elle sacrifiait pour ne pas éliminer sa sœur, à l’image de ce que, selon la légende familiale, avait fait jadis sa grand-mère.
En aidant Mariette à retrouver cette partie d’elle-même, à transformer l’image en parole, j’ai peut-être facilité une réconciliation profonde avec elle-même. Comme Zoé l’a fait pour Hanold, j’espère avoir contribué à libérer son Moi du désir de l’Autre, afin que ce Moi puisse devenir un Moi désirant, un Moi Nietzschéen, capable de voir avec ses yeux, de prendre avec ses mains, un Moi qui saisit son passé et refuse de perdre ce qui pourrait lui appartenir. Je l’ai également fait en partant de l’idée, formulée avec simplicité et éloquence par Ferenczi [14], selon laquelle celui qui se connaît sera de meilleur conseil que celui qui ne sait même pas qui il est, ce qu’il est, et ce qui pourrait le rendre vraiment heureux.
Références bibliographiques
Abraham N., & Torok M. L'écorce et le noyau. Paris : Flammarion. 2009.
Aulagnier P. La violence de l'interprétation. Paris. PUF. 1975.
Bonnet G. Les mots pour guérir. Paris. Payot. 1999.
De Mijolla-Mellor S. Le plaisir de pensée. Paris. PUF, 1992.
Ferenczi S. Science qui endort, science qui éveille. In, Œuvres complètes III (1919-1926). Paris. Payot. 1974.
Freud S. Le Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen (1907). Paris, Seuil. 2013.
Freud S. (1919). L'inquiétante étrangeté. Paris, Gallimard, 1985.
Freud S. Au-delà du principe de plaisir (1920). In Essais de psychanalyse. Paris, Payot, 1981.
Houbballah A. Destin du traumatisme, Paris, Hachette, 1998.
Jensen W. (1903). Gradiva, fantaisie pompéienne. Paris : Librairie Plon. 1992.
Lacan J. (1949). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je. In Écrits. Paris. Seuil, 1966.
Lacan J. Le Séminaire, Livre XIV : La logique du fantasme (1967-1967). Paris : Seuil, Collection Champ freudien. 2023.
Winnicott D.W. Jeu et réalité : Jeu et réalité. Paris. Éditions Gallimard, 1975.
[1] Jensen W. (1903). Gradiva, fantaisie pompéienne. Paris. Librairie Plon. 1992. P. 70.
[2] Freud S. (1919). L'inquiétante étrangeté. Paris. Gallimard. 1985. P. 240.
[3] Abraham N. & Torok M. L'écorce et le noyau. Paris. Flammarion. 2009. P. 297.
[4] Freud S. Au-delà du principe de plaisir (1920). In Essais de psychanalyse. Paris, Payot. 1981. P. 55.
[5] Freud S. Le Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen (1907). Paris. Seuil. 2013. P. 157.
[6] Winnicott, D.W. Jeu et réalité. Paris. Éditions Gallimard. 1975.
[7] De Mijolla-Mellor S. Le plaisir de pensée. Paris. PUF. 1992. P. 205.
[8] Lacan J. (1949). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je. In Écrits. Paris. Seuil. 1966. P.100.
[9] Bonnet G. Les mots pour guérir. Paris. Payot. 1999. P. 158.
[10] De Mijolla-Mellor S. Le plaisir de pensée. Paris. PUF. 1992. P. 207.
[11] Aulagnier P. La violence de l'interprétation. Paris. PUF. 1975. P. 101.
[12] Houbballah A. Destin du traumatisme. Paris. Hachette. 1998. P. 238.
[13] Lacan J. Le Séminaire, Livre XIV : La logique du fantasme (1966-1967). Paris. Seuil, Collection Champ freudien. 2023. P. 213.
[14] Ferenczi S. Science qui endort, science qui éveille. In, Œuvres complètes III (1919-1926). Paris. Payot. 1974. P. 246.
_________________
Illustration : Victoire ailée portant un trépied. Fresque du troisième triclinium de Moregine, IVe style pompéien, époque néronienne (vers 64 apr. J.-C.). Actuellement exposée à la Grande Palestra de Pompéi.